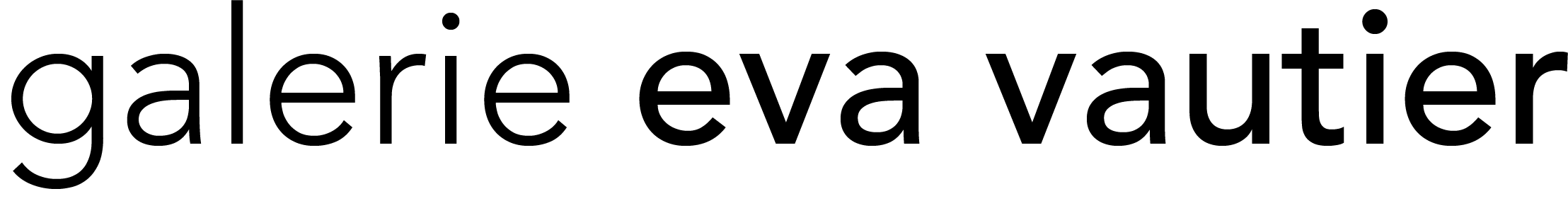Hors les murs – 2025 – Nicolas Daubanes – La main en visière

Hors les murs – 2025 – Jacqueline Gainon – Paysage(s)
"On entre par un dézoom.
L’exposition s’ouvre comme une scène déjà en cours, où des silhouettes à l’échelle du corps, sérigraphiées directement sur les murs, composent une farandole étrange entre danse folklorique et théâtre d’ombres. L’atmosphère est douce, presque joyeuse, mais grince par endroits. Une danse macabre, malicieusement mise en scène, comme si les figures clignaient de l’oeil depuis l’au-delà.
Caroline Rivalan conçoit Contre- Envoûtement comme un sortilège inversé. Il ne s’agit pas d’une œuvre sur la magie, entendue comme pensée symbolique qui attribue aux images un pouvoir opérant et agence des archétypes pour ordonner le monde, mais d’un usage de la magie pour tenir tête au réel, déplacer les signes, redistribuer les forces, fissurer ce qui se présente comme évident.
Au cœur de l’espace, six voilages verticaux d’environ 60 x 300 cm proches des noren japonais, installent le rythme. Transparents et traversés de paysages-mémoires, ils ne décorent pas, ils agissent. Le paysage n’est plus un fond, il devient acteur et mémoire en mouvement. Des puits de lumière scandent la traversée, des piliers gainés de miroirs sans tain démultiplient les apparitions, déplacent des fragments d’espace et convoquent par éclats l’imaginaire de Las Pozas, jardin surréaliste mexicain où l’architecture se fond en végétal.
La genèse du projet remonte à un moment où la parole publique s’est durcie, s’est simplifiée, s’est virilisée. À la faveur des réseaux,
une rhétorique masculiniste s’est décomplexée, jusqu’aux mouvements incel, à la fois symptôme et catalyseur d’un ressentiment misogyne devenu parole publique, un fléau dont les codes et les mots d’ordre se diffusent. Face à ces dérives, Rivalan ne répond ni par le slogan ni par le manifeste, mais par des images, des matières et des présences. Le titre rend hommage aux contre-envoûtements de Victor Brauner, un geste à la fois ironique et sérieux, non-pour conjurer le mal, mais pour dévier ce qui l’alimente.
Le visiteur n’est jamais devant une oeuvre, il est dedans. Il circule entre surfaces réfléchissantes et grands tracés, pris dans un climat plutôt que dans un accrochage. Tout semble glisser, repères, images, corps, rien ne demeure stable. Ce flou est voulu. Rivalan brouille les frontières entre réel et fiction, entre soi et l’autre, entre passé et présent.
Elle travaille à partir d’archives, de vieilles images, de figures oubliées. Plutôt que de les montrer, elle les découpe, les imprime, les détourne, les fait reparler. Résonne ici la notion d’image survivante chère à Aby Warburg et Georges Didi-Huberman, l’idée qu’une image traverse les époques, porte des affects anciens, des gestes enfouis, et ressurgit là où on ne l’attend pas.
Dans cette exposition, le décor n’est jamais neutre. Les miroirs et les murs jouent un rôle. Tout devient acteur. Le corps féminin, omniprésent, apparaît sous forme de silhouettes, de fragments, d’apparitions. Ce ne sont pas des personnages, ce sont des présences. Elles ne racontent pas une histoire, elles fabriquent un espace. Un espace où le féminin refuse l’assignation, où il devient force de dérive, de désordre, de transformation. Pas de revendication directe, mais un travail de déplacement et de recomposition.
Ce qui frappe, c’est le mélange des tons. On passe du grotesque au gracieux, de la légèreté à une inquiétude sourde. S’installe un trouble doux, peut-être le véritable contre-envoûtement, non pas l’offre de certitudes, mais l’ouverture d’une zone de bascule où les images hésitent, flottent, nous regardent à leur tour.
“L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde.” (Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, 1942.)
Sans l’illustrer, l’exposition met en scène des rapports de force, elle n’explique pas, elle déplace, et c’est ainsi qu’elle résiste."
Haily Grenet