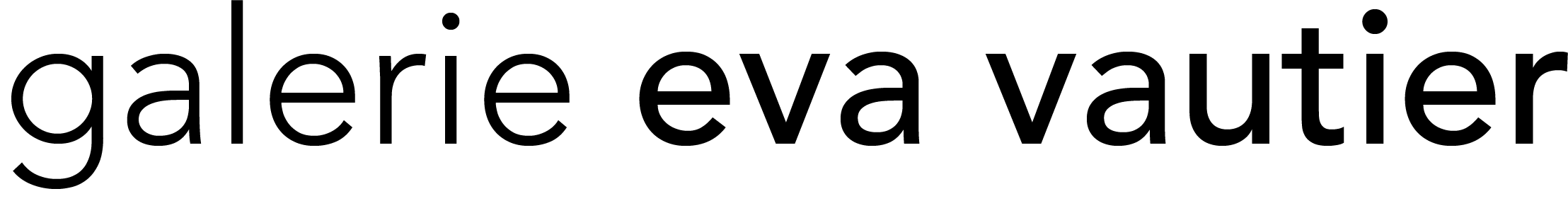Hors les murs – 2015 – Natacha Lesueur – Exposition « Chercher le garçon » Frank Lamy

Hors les murs – 2015 – Frédérique Nalbandian – Installation au jardin des grenadiers – CHU Nice
« A peine sortis de l’exposition du Musée Chagall de Nice, voilà quelques mois, où Natacha Lesueur exposait des photographies comme des reliques compassées d’une vision de l’exotisme, sortes de cartes postales revisitées de la Polynésie Française sauvagement déformée par les regards de touristes et de colons, nous sommes aujourd’hui face à des photographies et des céramiques récentes, dans un bien étrange état. Parlons d’une douce excitation.
De la Galerie Eva Vautier à la Galerie de la Marine, nous sommes tiraillés par ce qui caractérise les photographies de Natacha Lesueur : un ensemble de sensations puissantes et violentes rattrapées par un art de la scénographie et de la couleur, teinté d’humour, de plaisir et de légèreté. On passe de sensations d’attraction et de répulsion, à de la fascination, puis de la transgression à la poésie. Se téléscopent réalisme et mystère, pudeur et impudeur, décalage et drame, charme de la séduction et dégoût des matières. Les stéréotypes se fabriquent sur et pour le corps humain et son image, et finissent par jouer contre lui, mais ils génèrent des faisceaux de créativité par des procédés subversifs. Tout ce que les clichés portent en eux de tragédies, sont autant d’énergies et de pulsions antagonistes, autant vitales que mortifères. Entre trash et glamour, les modèles tiennent des poses de stars sculpturales qui seraient trop impeccables, trop hollywoodiennes si le maquillage outrancier ou les couleurs passées, décolorées, ne soulignaient une expression triste, absente, mièvre ou désabusée donnant un autre éclairage de la photographie publicitaire ou cinématographique. Pas de Photoshop pour la chambre, pas de gommage pour ce qui est qualifié d’imperfections dermatologiques, défauts de fabrication génétiques, mais au contraire, lumière et précision des détails qui configureraient notre propre ADN.
Le monde lisse et parfait des papiers glacés n’existe pas et les femmes qui en sont les objets mis en lumière sur fond noir crèvent leurs images, sous le poids de leur image. Choucroutes surdimensionnées, couleurs de chevelures sculptées effet plastoc, brûlures comme au chalumeau de la coiffe, trous, boursoufflures, cicatrices, viennent troubler un ordre invasif comme le pétrole. Il y a toujours ici quelque chose qui cloche. Politiquement incorrect. Un ordre confit, si l’on n’apercevait, de façon fine et raffinée, extrêmement bien dosée, l’équilibre des failles : le cheveu abandonné sur le vêtement, la veinule sur la jambe, le réseau routier des seins d’une femme enceinte qui d’ordinaire ne pose pas dans cette situation intime, l’apparition soudaine d’une bretelle de soutien-gorge, le ventre rond qui perce le vêtement. L’intimité sourd ici, où tout en principe est mis en œuvre, en scène pour l’effacer et la personnalité avec.
Partant de photographies repères de 1996, (je repense à ses interventions sur le corps comme les ongles sculptées en forme de pointe de lances ou de flèches) la quasi préhistoire de l’artiste, voici une femme à quatre pattes, avec une robe de soirée courte et moulante. Elle serait presque obscène si ses mules n’avaient pas été trop petites et si le corps tronqué privé de tête ne venait pas perturber la lecture de la pose par l’anonymat et enfin, si l’empreinte de bas absents ne révélait pas leur présence suggérée, leurs marques. Encore une fois tout contribue à faire dégringoler la magnificence d’une esthétique classique en noir et blanc qui serait irrespirable, si une fille anorexique prépubère avait été choisie à la place de ce modèle-là. Tout ce qui échappe à notre contrôle permet des projections à échelle humaine. Il semble que dans le monde selon Natacha Lesueur, l’incongruité et les hasards de la peau (nous ne somme pas dupes, ils sont aussi maîtrisés) : son grain, sa carnation, sa fermeté et brillance, son relâchement, ses duvets, rassemblent tout un vocabulaire, un registre qui serait capable de redonner au corps sa propre expression et une relative authenticité, par le truchement des jeux de lumières et d’ombres.
Les photographies avec des gris, du noir et du blanc ne sont pas des photographies noir et blanc. Ce sont des photographies en couleur qui sont de noirs et de blancs. Si l’on prend les plus récentes, on aperçoit en bas une touche de couleur chair qu’il serait possible d’appeler “peinture”, rappelant ainsi que nous sommes bien dans le monde de la couleur et de la peau. Des photographies-tableaux, empruntent à la peinture, au delà des grands thèmes du portrait et de la nature morte, l’art de la composition et y introduisent un art de la décomposition en utilisant des matériaux organiques périssables comme les denrées alimentaires, les fleurs ou le corps, une sorte de retour au naturel qui est utilisé ici à d’autres fins de fabrication d’images vivantes. Des photographies-sculptures revisitent l’art du statuaire comme l’ont fait les artistes du XIXe siècle dans l’art des cimetières (Staglieno en demeure l’illustre illustration). Là les portraits-bustes de dos présentent des chevelures qui semblent modelées dans l’argile et sortir d’une archéologie antique. Tout semble figé, moulé, mais matières et lumières confèrent à ces pièces une puissance vitale tout à fait convaincante. De même, on lit la souffrance à pousser la quête sans fin d’une illusoire beauté, formatée dans les photographies comprenant des empreintes, ne serait-ce que de fleurettes incrustées dans la peau des bras et des mains, comme dans la photographie de la femme à la voilette à l’attitude étrangement sage et imperturbable. Interventions à même la peau comme surface graphique qui n’est pas ici du body art.
La couleur explose dans la série bluffante des photographies en écho à l’artiste brésilienne des années 40, chanteuse et danseuse, à la peau blanche, Carmen Miranda qui vit son heure de gloire sous les projecteurs d’Hollywood et dans la société américaine en mal de conquête des pays latinos. En étanchant sa soif d’exotisme sur fond de samba et de fantaisie, de bonheur et de fêtes factices, en extrapolant son regard sur la négritude en blanc, le star système aura essoré à l’extrême une image de femme. Celle-ci ne tiendra plus que grâce à l’alcool et aux médicaments jusqu’à sa mort prématurée. Conséquence du tropicalisme à deux balles en parallèle de la négritude naissante (Duke Ellington et Sidney Bechet, Césaire et Senghor) sur fond de racisme. Extraordinaire casting de modèles qui portent la beauté là on l’on ne l’attend pas : un sourire mièvre, un regard vide, un gros ventre, un bout de chaise qui surgit de sous un tissus en manque d’ourlet, un geste de danseuse timide, des étais qui rappellent d’une architecture sa fragilité et la fragilité du monde. Puis comme allusion à la mort, des fruits pourris ici ou des fleurs fanées et glauques pour des femmes vases plus que femmes cruches, ou sur un corps aux seins appétissants constituent un décor dans lequel se fond le modèle. Les photographies affichent sur des succédanés de stars délavées par la lassitude, des grimaces, des sourires cabotins de chattemite et mimiques, regards tristes et absents, visages aux angles parfois androgynes, sourires enfantins et blasés en trompe-l’œil.
Dans ce florilège de propositions dynamiques, on surprend une boucle d’oreille de travers dans deux photographies aux décors en bleu, dans lequel se glisse le modèle statique (n’avez-vous jamais passé votre tête dans ces décors de carton pâte de foires pour vous faire immortaliser ?). La douceur des lèvres entrouvertes, les cheveux redéfinis dans une peinture fraîche, une rose peinte à même la peau, un dos dans une robe de face, c’est-à-dire un modèle recto puis verso dans le recto de la robe. Foisonnent les éventails de techniques dans un festival de couleurs et de colorisation vintage, de décoloration, de surexposition jusqu’aux posters qui montrent d’un paysage méditerranéen cibachrome, l’envers d’un décor surfait (son ciel bleu azur est zébré comme un bonbon Haribo par les tracés des réacteurs d’avion, sa végétation luxuriante, ses couchers de soleil spectaculaires). Le paysage sert de support à des faïences mettant au rang d’illustres personnalités, des femmes symboles d’un faste absurde daté. Elles reposent sur des socles alignés sur l’horizon d’un paradis perdu.
Comment ne pas voyager alors vers les tenues de la Frida Kahlo révolutionnaire, adoubée par des collectionneuses américaines dans ses tenues folkloriques chargées de bijoux, de fleurs et de feuilles, avec singes, chiens et daims, ou statuettes africaines (Diego Rivera les collectionnait) et revendiquant un art de la mise en scène de sa vie et de son corps, dans sa peinture comme dans les poses offertes à des photographes tels que Murray, tirant leurs origines dans la culture traditionnelle mexicaine. Je songe à Joséphine Baker, à la revue noire, et à ses affinités avec les cubistes et les jazzmen, à sa Banana dance torride et comique des années 20. L’une comme l’autre exaltent les caractéristiques de ce qui était considéré à l’époque comme sauvage, dans des processus artistiques dont elles sont restées maîtresses.
Ce n’est pas le cas d’une Carmen Miranda dont on peut se demander si elle n’est pas, en quelque sorte, une réplique de la Côte d’azur, ni des stars qui ont été des sortes de victimes comme elles, prises à leur propre jeu de miroir aux alouettes. Carmen Miranda et ses tenues baroques, saisie dans des décors exotiques de strass et de paillettes, icône fabriquée par un système mercantile et expansionniste, broyeur des singularités, rejoint avec ses énormes corbeilles de fruits, le registre du vocabulaire alimentaire cher/chair à Natacha Lesueur (les aspics qui recouvrent les crânes, comme des peintures avec des palettes d’aliments). Déconstructions et constructions sont prétextes à la jubilation propre à cette création-là qui rutile, par son incroyable expression d’une liberté offrant à notre regard un monde un peu plus digeste.
Lire les photographies de Natacha Lesueur avec les grilles de la sculpture et de la peinture laisse poindre de larges perspectives. Les forces antagonistes qui se dégagent de son œuvre donnent à ce qui s’éteint du monde une énergie positive et les moyens de son renouvellement. «
©Sophie Braganti
Retrouvez l’auteur et son article sur aicafrance
©photographies Natacha Lesueur :
Carine, 2015, 100 x 80 cm, Photographie analogique, Épreuve Lambda sur ilfoflex
Sans titre, 2015, 60 x 60 cm, Photographie analogique, Épreuve baryté