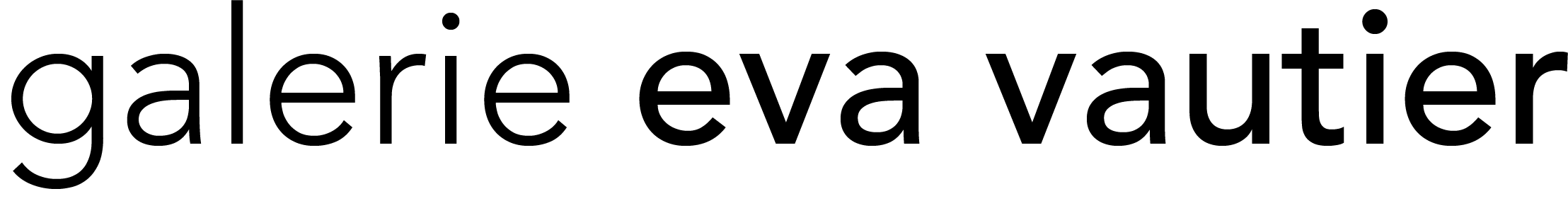simone simon
au rythme du paysage
Avec Linda Sanchez, artiste invitée dans le cadre du festival OVNi.
Cette nouvelle exposition Simone Simon présente la dernière série de photographies de l’artiste, Histoire d’eau, fruit de multiples voyages en Islande, Picardie et au bord de la Méditerranée.
Dans le cadre du festival OVNi (Objectif Vidéo Nice), simone simon présente l’installation vidéo au rythme du paysage et Linda Sanchez (Prix Révélations Emerige 2017) artiste invitée, présente le film 11752 mètres et des poussières...
Exposition
Du 07 octobre au 2 décembre 2023
Vernissage le vendredi 6 octobre à 18h.
- Vue de l’exposition au rythme du paysage , Simone Simon oct 2023, galerie Eva Vautier Photo © François Fernandez
Selon Chiara Palermo, commissaire d’exposition et docteur en philosophie « Dans la série Histoire d’eau, le dialogue intervient autrement [que dans les précédents projets de l’artiste]. Il se fait danse par le mouvement
de la photographe, la parole devient geste et l’image est le résultat de cette communication sans discours qui anime l’image. [...] Nous pouvons reconnaître la proximité avec les projets précédents de l’artiste issue d’une stratégie militante et esthétique qui cherchait souvent des points d’attaque idéologiques pour dénoncer la transformation en acte de la société dans son homologation et dans sa réification consumériste. Elle faisait jouer les émotions, la différence, la marginalité des récits des histoires acquises, par des narrations plurielles. Dans Histoire d’eau, elle joue la pluralité de l’image et la discontinuité de chaque instant, sans renoncer à un réalisme qui caractérise son œuvre. »
--
Gilles Renault, dans Libération, en mars 2023, après Histoire d’eau, exposition personnelle de simone simon à l’Ecole des Beaux Arts de Versailles :
« Les paysages évanescents de simone simon conservent jalousement leur part d’énigme, contrées flottantes, indécises, sans frontière ni démarcation, où les éléments solide et liquide cohabitent, se superposant en un délicat dialogue teinté de mélancolie atemporelle, tout au plus troublée par ce qu’on devine être l’envol d’un oiseau. De l’Islande à la baie de Somme, l’humain n’a, en revanche, pas ici sa place, indésirable qu’il est sur ces bandes verticales qui renvoient souvent à un registre pictural conviant à la contemplation. »
AU RYTHME DU PAYSAGE | CHIARA PALERMO
Le bruit incertain des rêves est en décadence La personne humaine devient personne Son langage la prothèse de ses peurs [...] Bégayer ce qui est mort dans notre bouche Par exemple, l’enfance. Mais non en récupérant les règles, les pièges du jeu puéril ; le jeu, tu vois, est juste de pouvoir dire que A n’est pas nécessairement égal à A le jeu est de pouvoir dire que A peut être égal à tout autre chose. Et jouer veut dire aussi, ou essentiellement, être joué [...] Nous sommes vivants dans la mesure où nous savons reconnaître Si nous rencontrons quelque chose [...] L’espace n’est pas seulement un vide à remplir [...] Vivre est comme l’aiguille qui traverse le pouce [...] Il m’intéresse à présent de rechercher ce qui dans les temps a été effacé L’autre de moi Mon inconnu Il pleut ou il ne pleut pas...ou... . Nanni Cagnone Les derniers projets de Simone Simon ont connu une inspiration sociale et politique, depuis Les portes du Saint-Pierre (2008) en passant par Ne regardez pas le renard passer (2017) ou Nu (2018). Comment pouvons-nous reconnaître l’auteure dans ce dernier travail autour du paysage ? Comment faut-il interpréter cette série Histoire d’eau ? Est-ce qu’il s’agit d’une fuite de l’effet d’accélération de notre société pour un idéal de retour romantique à une fusion avec la nature ? Voilà quelques-unes des interrogations qui ont accompagné ma découverte de ces images. Voir plus
Linda Sanchez (Prix Révélations Emerige 2017) artiste invitée, présente le film 11752 mètres et des poussières...
Dans son travail de sculpture, Linda Sanchez semble avoir cherché une sorte d'équilibre précaire, une peau légère qui se situerait entre un objet et la surface sur laquelle il se trouve : il y a quelques années, elle détachait délicatement un Tissu de sable de sa dune originelle, cherchait à découvrir les différences inframinces entre un tronc de bois coupé et le même poncé de quelques centimètres, ou encore présentait de bien vulnérables toiles d'araignée.
Pour son exposition personnelle à la Fondation Bullukian, l'artiste a choisi de concentrer sa recherche sur un objet infime, presque le plus petit dénominateur commun des phénomènes météorologiques, la goutte d'eau.Voir plus