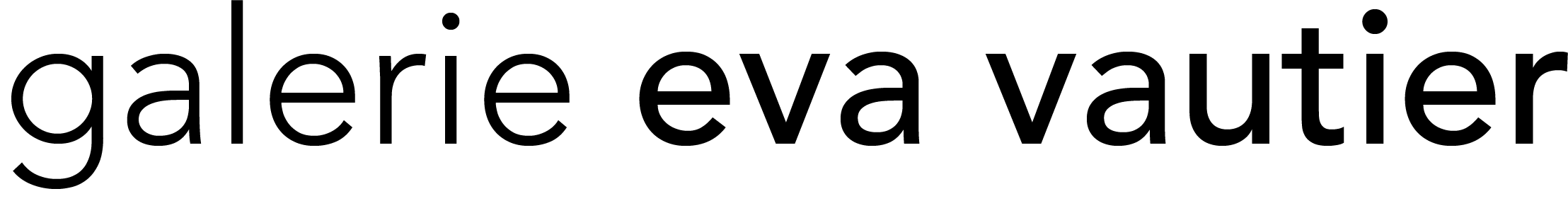Marc Chevalier
Pouvoir faner, vouloir fleurir
Exposition passée
Du 14 décembre 2024 au 8 février 2025
Vernissage le vendredi 13 décembre à 18h
La Galerie Eva Vautier est heureuse de présenter pour la seconde fois une exposition personnelle de l’artiste Marc Chevalier. Après sa première exposition en 2020, Les tableaux n’existent pas, où il repoussait les limites de la peinture, Marc Chevalier nous propose cette fois un dialogue entre œuvres récentes, spécialement créées pour cette occasion, et pièces plus anciennes.
Diplômé de la Villa Arson à Nice en 1993, Marc Chevalier participe à la création de La Station (artist run space) en 1996. Après un parcours artistique qui le mène de Paris à Berlin, il revient en 2012 à Nice, où il poursuit aujourd'hui ses expérimentations. Pour lui, l’idée ne précède pas l’œuvre, elle s’élabore durant la fabrication de celle-ci, au gré d’actions et de rétro-actions entre forme et contenu.
Artiste à la pratique protéiforme, il explore différents modes d'expression, refusant de se limiter à un seul langage artistique ; ainsi l’on peut voir transparaître au travers d’une sculpture les rémanences d’un dessin, d’une peinture ou d’une performance. Chaque œuvre témoigne d’une inspiration multi-médiumnique, par laquelle la perception du regardeur se construit et s’affine. Marc Chevalier donne l’impulsion à une prise de recul, il nous convie à faire l’expérience d’une contemplation active.

Texte de Christian Bernard
Marc Chevalier ou la nostalgie d’aujourd’hui
L’exposition de Marc Chevalier, Pouvoir faner, vouloir fleurir, se présente en deux ensembles dissemblables logiquement logés dans les deux espaces principaux de la galerie Eva Vautier. D’abord des tableaux puis des sculptures. Une autre série de tableaux est exposée à l’étage.
Peintures sans tableaux et tableaux sans peinture
Ce que l’artiste appelle « tableaux », ce sont, pour le citer, « des peintures sans une goutte de peinture », des peintures réalisées avec des rubans adhésifs publicitaires, plus au moins translucides, tendus sur le châssis sans autre support. La couche « picturale » se dispense de la toile. Les éléments imprimés sur les rubans adhésifs fournissent la couleur et les rubans eux-mêmes tiennent lieu de toile. On voit là tout le savoir-faire déconstructeur de M. Chevalier.
La suite de ces tableaux carrés de petit format (20 x 20 cm) ici montrés se tient à mi-chemin entre image et abstraction. Des mots s’y glissent partout (ceux de la publicité, un usage particulier du langage et des signes), participant à la structuration dynamique des surfaces.
Le plus fréquemment, des lignes rayonnant à partir de la zone centrale produisent une image-sensation d’explosion, de vortex, de maelström qui peut remémorer certaines oeuvres suprématistes ou constructivistes ainsi que le style graphique de la communication visuelle publicitaire ou de la propagande politique d’entre les deux guerres mondiales. Il s’y noue une tension qui semble devoir déborder du cadre tant l’idée du mouvement y domine.
Chevalier, dès l’école (en l’occurrence la Villa Arson), s’est employé à continuer la peinture par d’autre moyens que la couleur appliquée sur la toile. Ses premiers tableaux en « scotch » datent de cette époque. Les rubans adhésifs alors employés étaient simplement monochromes et les tracés qu’ils matérialisaient étaient organisés de façon orthogonale. La couleur s’y confondait avec la forme. L’abstraction géométrique en constituait le background. Le dernier Mondrian et Barnett Newman tenaient lieu de lointains prédécesseurs. À l’opposé, les tableaux d’aujourd’hui évoquent aussi l’univers graphique de certaines bandes dessinées et du pop art en général. Ils semblent exprimer un sentiment d’urgence, de confusion ou de panique.
Les petits tableaux accrochés à l’étage appartiennent à une autre manière, aussi ancienne que les scotchs. Ce sont les « flaques ». Ils sont formés de petites flaques de peinture liquide versée sur des sacs en plastique imprimés, issus du commerce. La couleur y sèche, absorbant plus ou moins les inscriptions du sac. C’est une sorte de dripping sans le dessin, de décalcomanie involontaire. La forme est celle informe de la flaque. Ensuite, l’artiste superpose plusieurs de ces flaques de peinture sans support pour aboutir à une façon de tableau mou, épinglé au mur, des peintures sans rien d’autre. Ainsi se continue la peinture, tout en se privant du confort ancestral de la toile tendue sur châssis et de l’intention de faire image et de tracer une forme ou une figure. Là encore, la peinture est déconstruite, démontée et remontée, rejouée autrement. Dans une logique voisine de l’esprit Fluxus, M. Chevalier laisse faire la matière liquide, il se contente d’apparier et de coller les résultats entre eux. Puis il leur donne un titre sans commune mesure avec leur taille (autour de 20 cm de côté) : « Deux mètres trente par deux mètres quatre-vingts » par exemple. Cette contradiction introduite dans le cartel suggère que ce serait la taille possible ou souhaitable de la peinture dont nous regardons alors la version miniature. Ici affleure un peu de l’humour qui traverse toute cette oeuvre.
La géométrie dans les broussailles
La salle consacrée aux sculptures pourrait donner à croire que l’on a affaire à un autre artiste. Il n’en est rien et l’on pourrait également dire de ces pièces qu’elles continuent la scupture par d’autres moyens.
L’histoire de la sculpture connaît un tournant majeur quand elle s’émancipe de ses gestes instituants comme la soustraction (qui retire de la matière dans un bloc), le modelage ou l’agrégation (dont l’assemblage est l’extension). Elle quitte bientôt le socle, se défait de toute expressivité, se confronte au mouvement ou réfléchit sur ses données constitutives. La sculpture du XXe siècle s’est employée à ne plus être ce qu’elle avait été des siècles durant. C’est son moment moderne. Et c’est dans cet horizon analytique qu’il est loisible de regarder le travail récent de M. Chevalier. Ses oeuvres tridimensionnelles, installées dans l’espace d’exposition, y tiennent lieu de sculptures. Elles se dressent au-dessus du sol, elles s’adossent aux murs, elles tiennent debout dans un équilibre apparemment précaire, elles dessinent de leurs lignes des écheveaux qu’un souffle pourrait suffire à abattre.
Les matériaux utilisés pour édifier ou composer ces sculptures viennent presque tous du monde végétal : fleurs, tiges de graminées, brindilles, maigres bâtons, chardons fanés, cannes de Provence, collectés sur les bords du Paillon, c’est-à-dire dans la proximité de l’atelier niçois de l’artiste. Nul exotisme ici. Ce sont des plantes familières, pauvres, sans prestige, que l’été sèche vite, des survivantes des talus. Ce choix des moyens donne le la de cette oeuvre. La pérennité n’est pas son but, la fragilité est sa condition. Avec ces fines tiges jaunies, M. Chevalier construit ses sculptures qui leur confèrent une seconde vie. Leur association se fait simplement avec du ruban adhésif. L’hétérogénéité des deux éléments est au coeur symbolique de ce travail d’hybridation et d’entage : des seringues y contribuent, fixées aux points de connexion des formes (l’icosaèdre, par exemple). Sur la faiblesse inoffensive des « mauvaises herbes » ici employées, elles greffent des objets durs, piquants et agressifs qui proviennent des univers ambivalents de la thérapie et de la drogue.
L’espace d’exposition est saisi par ces sculptures qu’il associe et dont les éléments sont des traits, des lignes qui dessinent dans l’espace, qui dessinent des espaces. À ce titre, elles se situent dans le sillage héroïque des oeuvres « filiformes » de Julio González[1] ou de Fausto Melotti[2], sans omettre les fagots d’un Mario Merz. Ce n’est pas pour dire que le travail de M. Chevalier serait savant et qu’il jouerait de citations validantes. Il ne fait pas commerce de ces souvenirs historiques, il en ravive la mémoire par ses intuitions propres.
On aura compris que l’activité plasticienne de M. Chevalier s’inscrit de facto dans une histoire de l’art dont l’époque s’est éloignée en changeant les paradigmes permettant de reconnaître l’art. Mais cette oeuvre radicale à maints égards appartient aussi à son temps par son économie, par son écologie, par son sens de la précarité et de la force paradoxale du peu et du faible. Quelque chose s’y murmure de notre incertain destin.
Christian Bernard, 9 décembre 2024.
[1] Petite danseuse III, 1934-1935, Grand personnage debout, 1932-1935, Maternité (linéaire), c. 1934, par exemple.
[2] Carro I, 1969, Il sacco, 1969, Festa degli alberi, 1970, Composizione libera, 1970, La medusa allo specchio, 1974, La camicia di Archimede, 1983, par exemple.
Vues de l’exposition de Marc Chevalier, "Pouvoir faner, vouloir fleurir", 2024, Galerie Eva Vautier © François Fernandez.

A l’étage de la galerie, Marc Chevalier a choisi d’inviter la réalisatrice Sandrine Perrin à présenter son film Kilomètre 84, Jacques Perrin.
Kilomètre 84, Jacques Perrin a été réalisé à partir d’images et de sons captés par un dispositif autonome : la boîte noire d’une voiture, témoin impassible d’une situation critique. Un plan-fixe déroule les images d’un accident ; les passagers du véhicule frôlent la mort et son ombre planera sur tout le film. Puis, d’autres protagonistes entrent en jeu, via les conversations téléphoniques enregistrées à l’intérieur de l’habitacle : la famille proche, les secours. Tous se trouvent pris dans une bande son parfois chaotique, tandis qu’à l’écran s’écoule le flux banal d’une autoroute de vacances. Le film s’écrit seul, servi par un présent qui semble soudain traversé par un arc électrique fictionnel. Le réel se transpose dans un double aux accents tragi-comiques, où se révèle la condition humaine.