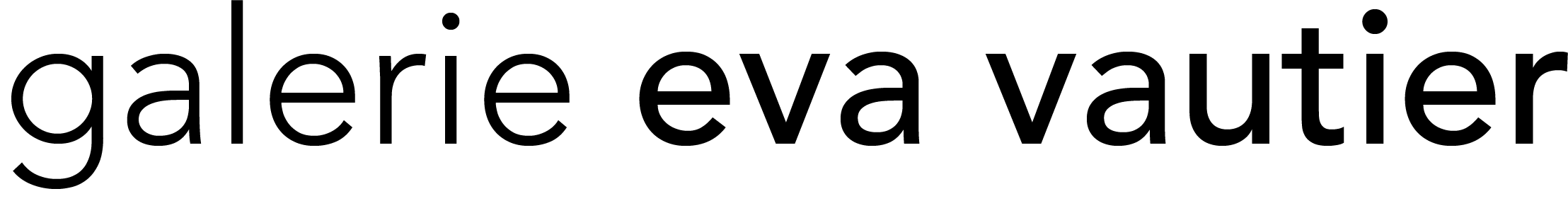Marc Chevalier
Les tableaux n’existent pas
Exposition 2020, passée
Du 15 février au 22 mars 2020
Vernissage le vendredi 14 février à 18h.
Ancien élève de la Villa Arson à Nice, Marc Chevalier en est diplômé en 1993. Il participe à la création de La Station en 1996, part ensuite à Paris puis à Berlin. Revenu à Nice en 2012, c’est désormais ici qu’il poursuit ses recherches artistiques sur, entre-autre, la représentation des mots : l’image mentale qu’il suscitent. C’est de ce désir que l’exposition Les tableaux n’existent pas est née. Il propose de transcender l’idée du tableau. La Galerie Eva Vautier, telle un « white cube » imparfait singulier, avec ses arêtes et ses irrégularités, devient lieu de fabrication à la recherche de la vérité de l’imaginaire du tableau.
Entre installation et performance, cette proposition est dans la continuité de son intervention lors de l’exposition Supervues, en 2016, à l’Hôtel Burrhus de Vaison-la-Romaine. Il devait alors, dans l’urgence, créer une œuvre dans une chambre d’hôtel. Partant de ce que l’on y trouve habituellement, suffisamment neutre pour ne déplaire à personne mais pas assez original pour marquer l’esprit de l’habitant de passage. L’artiste se pose alors la question de la représentation physique de l’idée du tableau. Est-ce une image ? Une peinture ? Un cadre ? A quoi pensez- vous en entendant le mot «tableau» ? Est-ce une idée radicale ou une idée bourgeoise ? A quoi sert le tableau ? Une question en entraînant une autre, le tableau doit-il servir à quelquechose ? Qu’est ce qui le rend beau ou laid? Est-ce un signifié protéiforme ? Le trait posé est une tentative, pas forcément réussie, de l’idée «tableau». Comment le besoin de représentation va-t-il se concrétiser ?
En réponse aux murs blancs de la Galerie, avec la pression de l’exposition qui doit se faire, des traits de représentation naissent dans l’urgence et dans le besoin de remplir cette surface vide. Le geste se veut instinctif, primal, voire primaire. La représentation doit être spontanée. Marc Chevalier refuse volontairement de s’exercer et de créer ainsi une habitude, avant de poser son seul bagage, le feutre de gouache sur les murs et faire naître des signes reconnaissables par tous. Evidemment, le discours a une portée plus universelle, tendant à essayer d’interroger sur l’idée que nous avons de l’art, de l’esthétique et de notre monde fantasmé.

Vue de l’exposition les tableaux n'existent pas , Marc Chevalier 2020, Photo © François Fernandez
Les tableaux n’existent pas l Catherine Macchi
Lorsque l’on rentre dans la galerie Eva Vautier et que l’on découvre le travail que Marc Chevalier a exécuté directement sur les murs, sans filet pourrait-on dire, pour l’exposition Les Tableaux n’existent pas, on en saisit rapidement la dimension performative. Invité sur la base d’une carte blanche, l’artiste a choisi de ne pas exposer sa production d’atelier mais plutôt de réitérer un geste qu’il avait inauguré à l’Hôtel Burrhus à Vaison-la-Romaine, dans le cadre de l’exposition Supervues, en 2016.
En effet, confronté à l’époque à un court délai, il s’en était sorti avec une de ces pirouettes dont les artistes contemporains ont le secret, dessinant d’un seul jet au feutre, sur le mur d’une chambre, deux grands tableaux abstraits d’un noir profond et au graphisme appuyé, dont le centre troué par une explosion de lumière blanche rappelait vaguement la série des Bursts de Gottlieb. Parés de cadres aux moulures insistantes, grosses comme des oreilles de Mickey, ils venaient faire un pied de nez aux tableaux-types que l’on trouve d’ordinaire dans les hôtels et dont l’esthétique moyenne, pour ne pas dire de mauvais goût, vise bassement à décorer sans trop perturber l’œil et l’esprit. Ironiquement intitulée Le tableau comme perversion bourgeoise, cette intervention sauvage et tapageuse qui s’amusait à rejouer les codes de l’expressionnisme abstrait réglait son compte à ce genre de peinture de paysages ou de marines insipides, laissant supposer que l’artiste de passage, en proie à une panne d’inspiration, s’était adonné avec irrévérence à un exercice contemporain de peinture rupestre.
À Nice, dans une situation d’urgence analogue, Marc Chevalier entreprend de développer cette idée d’une exposition sans tableau, c’est-à-dire sans objet, mais qui parlerait de ce qu’est la peinture, autrement dit l’espace de représentation, aussi bien pour l’artiste, que pour la galeriste et le public. Pour convoquer la peinture en son absence, l’artiste travaille au feutre gouache, outil qui le mène à la croisée du graffiti, du dessin et de la peinture. Sans effectuer de croquis préalable, il affronte le mur en esquissant des cadres de tableaux qui rappellent les encadrements moulurés en bois et dorés à la feuille d’or qui ont habillé toute l’histoire de la peinture occidentale de la Renaissance jusqu’à l’avènement de l’abstraction. Mais au lieu de cantonner le cadre à son rôle structurant et statique de frontière entre la représentation et le monde réel du visiteur, il en fait quelque chose de mobile et presque incontrôlable. On est loin des recommandations de Matisse : « Un tableau doit être tranquille au mur. Il ne faut pas qu’il introduise chez le spectateur un élément de trouble et d’inquiétude [...]. » 1 En effet, avec une série de gestes amples, rapides et répétitifs, Marc Chevalier donne une version excessive, presque baroque, de l’architecture du cadre qui, dans son envol lyrique et sa prétention, finit par prendre tout l’espace. Entendons par là que l’artiste prolonge le cadre à l’intérieur de la surface qui devrait être dévolue à la représentation comme si cet accessoire décoratif venait rivaliser avec la peinture pour tenter de la détrôner.
Il en ressort une série de onze ersatz de tableaux, réalisés successivement à raison de un par jour, qui expérimentent toutes les tailles, depuis les formats intimes de la nature morte ou de la scène de genre, jusqu’aux formats plus pompeux de la peinture mythologique ou religieuse. Mais quelque soit leur dimension, ils basculent tous, non sans jubilation, de l’esquisse la plus adroite vers le gribouillage le plus régressif. Or la délectation que semble avoir éprouvé l’artiste à déployer une gestuelle expressionniste et nerveuse est ici palpable et même contagieuse. Même a posteriori on imagine très bien Marc Chevalier, armé de ses feutres gouache, attaquer les murs de la galerie avec fougue et dextérité comme s’il venait parodier son propre geste pictural ou, plus largement, le geste mythique du peintre. Deux exemples historiques de peintres légendaires au travail viennent alors à l’esprit : d’une part, le Picasso filmé par Clouzot 2 qui dessine librement avec un gros feutre en transparence sur du papier et qui, dans la démonstration de sa propre virtuosité, finit à certains moments par en faire trop et gâcher son travail ; et d’autre part, les actions de Georges Mathieu qui s’apparentent à des combats avec la peinture où l’artiste s’emploie à jouer le rôle d’un héros du faire pictural au point de réifier sa propre gestualité abstraite en une sorte de signature névrotique sans fin.
Si elle ne se prend pas au sérieux, l’intervention de Marc Chevalier, qui débarque dans la galerie en dégainant son feutre, n’en comporte pas moins une prise de risque. Totalement improvisé, le geste inscrit sur le mur ne peut être effacé ni corrigé et, difficulté supplémentaire, il ambitionne de ne pas être répété, chaque tableau devant se distinguer des autres. Cette volonté de produire un geste vierge est propre à la pratique de l’artiste, habitué à arriver dans des lieux d’exposition les mains vides et à imaginer une œuvre in-situ avec les éléments à sa disposition. C’est ce qui s’était produit à Nice en 2014, dans le cadre de la manifestation Les visiteurs du soir, organisée par le réseau Botox, dans l’appartement d’Anne-Sophie Lecharme où Marc Chevalier avait décidé, sur place, de réaménager le salon en déplaçant son contenu mobilier.
C’est ainsi qu’il avait intégralement vidé les meubles et construit, entre autres, une bibliothèque avec un empilement de livres, attribuant au contenu le rôle du contenant. Flirtant avec le syndrome de Diogène, ce désordre apparent était ambivalent et pouvait paradoxalement se donner à voir comme une organisation différente de l’espace fondée sur de nouvelles hypothèses d’usage des objets. Le salon était ainsi réagencé en fonction d’étranges narrations et non plus sur la base du confort. Le résultat était aussi effrayant qu’hilarant, on avait l’impression que les objets s’étaient soudainement animés : à deux doigts de s’effondrer, l’architecture de livres s’élevait avec une inconscience toute acrobatique ; posés les uns sur les autres, cd, bibelots, verres et bouteilles s’érigeaient comme autant de châteaux de cartes ; d’abord vidée de ses tiroirs puis augmentée de ces derniers, une commode gonflée de hardiesse avait doublé de hauteur ; tandis que chaise, fauteuil et divan juchés sur des piles inégales de livres paraissaient danser la polka. Chez Eva Vautier, dans un exercice de freestyle différent, Marc Chevalier rejoue la carte de la surenchère et du tumulte tout en opérant un glissement de sens analogue puisqu’il donne au cadre de ses tableaux fictifs la même chair que celle de la peinture.
Lorsqu’il est arrivé dans la galerie, l’artiste a d’abord passé beaucoup de temps à regarder les murs blancs en se demandant quel type de tableau pouvait se cacher dans l’épaisseur des différentes cloisons. Il s’agissait de faire surgir des œuvres en tentant de trouver ce qui aurait pu être leur toute première étincelle de vie. Pour parvenir à cette épiphanie de la peinture, il fallait produire mentalement une image générique de tableau. Que reste-t-il d’un tableau quand on ferme les yeux ? Manifestement un gribouillage qui masque l’écart entre l’image de la peinture et la réalité cette dernière. Comme les meubles de la collectionneuse, les tableaux ont donc été vidés ici de leur contenu, ils ne donnent strictement rien à voir, ne restent que les cadres qui les définissent en tant que tels.
De la même manière, en dessinant les conditions d’apparition de l’objet tableau, Marc Chevalier en vient à faire exister l’espace vide de la galerie et lui restitue pleinement sa fonction. On a ainsi affaire à une sorte d’exposition au conditionnel qui énoncerait : là il y aurait ce tableau, ici cet autre, etc. Il n’y a rien à encadrer qu’une idée du pictural et finalement ce sont peut-être les murs de la galerie qui deviennent la chose à encadrer. Le cadre se transforme alors en motif et devient le seul sujet de cette exposition dématérialisée.Il est clair que pour Marc Chevalier, cette opération de disparition du tableau se situe dans la lignée des gestes de démystification de la peinture dont on trouve les sources dans les Arts Incohérents. Fondé en 1882, par l’écrivain Jules Lévy, ce collectif qui regroupait essentiellement des écrivains, des illustrateurs et des caricaturistes, ambitionnait de faire des expositions sur la base de l’absence de compétences et de la dérision dans des contre-salons où des œuvres sans qualité étaient primées avec des médailles en chocolat. Faisant triompher l’absurde et la politique de table rase bien bien avant le dadaïsme, ce mouvement qui raillait la peinture officielle avait notamment inventé le monochrome en tant que concept mais également la désubstantialisation pure et simple de la peinture avec l’exposition de cadres vides.
L’exemple des Incohérents est intéressant car il est emblématique de deux choses importantes ici, d’une part, l’appartenance du geste de Marc Chevalier à toute une tradition du dessin satirique et, d’autre part, la dimension contestataire de ce geste vis-à-vis de la valeur marchande de l’œuvre d’art. Pour ce qui est du premier point, il suffit de suivre des yeux les lignes tracées par l’artiste pour comprendre qu’il a intégré des conventions graphiques propres au dessin de presse et à la bande-dessinée. Non seulement, Marc Chevalier ne dessine pas de façon mimétique la forme d’un cadre, préférant plutôt un schéma immédiatement identifiable et très emphatique de ce que peut être une toile de maître dans n’importe quelle vignette de comic, mais il entoure cette image d’une série de petits traits qui semblent exprimer une émotion de beauté et de vie intérieure de l’objet peinture, voire son coût exorbitant. Tout se passe comme si l’artiste lui- même faisait des commentaires sur la peinture en faisant des allers-retours entre le dedans et le dehors du tableau mais en veillant à garder la même énergie.
Quant au second point, il est évident que la proposition que Marc Chevalier fait à sa galerie d’exposer une œuvre que l’on ne peut ni décrocher dans le but de la vendre, ni restituer parfaitement à l’identique sur les murs d’un particulier ou d’une institution (contrairement à un dessin mural de Sol LeWitt), rejoue l’histoire des rapports ambigus entre artistes, marchands et musées depuis l’invention de l’art moderne, histoire qui s’est dessinée autour du déclin de la peinture académique, puis de la disparition pure et simple de la peinture et même de l’objet d’art. On ne peut à cet égard que souligner l’ouverture d’esprit d’Eva Vautier, formidable galeriste qui accompagne avec enthousiasme les projets de ses artistes.
L’humour contenu dans le geste de Marc Chevalier qui suggère à sa galerie une exposition de tableaux grandiloquents mais intangibles et par conséquent pratiquement invendables n’est pas sans rappeler la parabole sur la vanité et le monde des apparences du célèbre conte d’Andersen « Les habits neufs de l’Empereur » 3. Mais là où la duperie des deux tisserands malhonnêtes fonctionnait par soustraction en faisant miroiter au monarque orgueilleux l’existence d’une étoffe somptueuse mais invisible pour l’oeil des sots, la farce de l’artiste qui remplit la galerie de tableaux illusoires opère inversement par adjonction de strates graphiques jusqu’à saturation. Si pour l’enfant « Le roi est nu ! », il n’est pas impossible que le visiteur estime que ces tableaux ne sont qu’un écran de fumée. De la transparence au gribouillis, il s’agit toujours et encore de vide et d’absence. Et du roi au collectionneur, il n’y a qu’un pas.
On l’aura compris, il est question ici de vanité, non pas en tant que genre pictural dans lequel une nature morte est mise en regard avec un crâne, symbole de finitude, mais en tant que travers du collectionneur désireux de posséder une œuvre rare et convoitée. En rendant les œuvres inaccessibles dans le sens où on ne peut réellement en faire l’acquisition, Marc Chevalier court-circuite les rouages du marché de l’art et en parodie le mode de fonctionnement ; inaccessible étant aussi synonyme d’inabordable. Et par la même occasion, il démonte les mécanismes du désir qui poussent les collectionneurs à posséder une pièce signée par tel ou tel artiste.
En effet, si ses tableaux dessinés au mur évoquent de nombreux peintres, ils ne renvoient à personne en particulier, pas même à sa propre peinture. Or l’impossibilité de toute identification met purement et simplement en échec le désir de possession du collectionneur. Marc Chevalier joue un coup dans un jeu auquel, toutefois, il n’est pas exclu que le collectionneur averti réponde.
Au-delà de la critique du milieu de l’art, l’absence d’étiquette confère à l’œuvre une forme d’autonomie et la sauve peut-être de sa réification en la positionnant dans un état de virginité relative qui interroge sur la façon dont nous apprécions l’art. L’occasion étant ici donnée au public de contempler un tableau avant de savoir qui en est l’auteur.
La superbe de l’artiste, la vanité du collectionneur, la cupidité du milieu marchand ne sont pas les seules cibles de cette opération en carton pâte de destitution du prestige de l’art. Toutes les croyances quant à la valeur plastique, émotionnelle, intellectuelle et morale de la création artistique tombent également pour le simple regardeur dès lors que l’on prend le titre de l’exposition à la lettre. Marc Chevalier ramène ici à la dimension intouchable de la peinture en tant que lieu de représentation et espace d’une pensée non verbale : « Les tableaux n’existent pas. On a simplement rendu les images mobiles quand on cessé de les faire sous forme de fresques pour les réaliser sous forme d’objets déplaçables. C’est lorsqu’on encadre ces objets qu’ils deviennent des tableaux : le cadre isole du contexte, c’est un élément ornemental. Il y a quelque chose de l’ordre de l’inaccessible dans la peinture. Posséder une œuvre d’art ce n’est pas avoir l’objet. Ici on ne va rien pouvoir avoir et pourtant c’est bien cela qui stimule le désir. » 4
L’art serait donc du ressort de l’impossibilité, d’ailleurs les tableaux que Marc Chevalier improvise au mur ne sont que des chimères. Ils synthétisent des codes et des standards incompatibles qui les rendent parfaitement inopérants et improbables. Ils sont, en effet, encadrés comme de la peinture d’avant 1914 et se donnent pourtant à voir comme des fleurons de l’abstraction lyrique d’après 1945. Malgré la pompe des cadres, ces tableaux font ressurgir le fantôme de Pollock et, inversement, bien qu’ils soient abstraits leurs encadrements ornementés appellent tous les chefs-d’œuvre de la peinture figurative. En créant ces hybrides, Marc Chevalier condense tradition et modernité et nous amène à comprendre comment le tableau, privé de son cadre dans la seconde moitié du XXe siècle, devient cette chose indéfinissable et insaisissable qui distille la plus haute idée de l’art. Dans un texte de 1998, au sujet des calligraphies imaginaires qui se déployaient dans ses tableaux réalisés avec du ruban adhésif, l’artiste affirmait « essayer de représenter un irreprésentable de la représentation. » Si les moyens ont changé, l’objectif garde la même audace.
Comme dans un certain nombre d’autres interventions qui dépassent le domaine de la peinture pour toucher à l’installation, Marc Chevalier articule de façon paradoxale une impérieuse esthétique de l’excès, voire de l’exubérance, avec un sentiment de vacuité qui tient de l’évidence. À travers ces éléments antinomiques, il s’agit de réactiver le fantasme de la peinture et de sonder l’aura de l’œuvre d’art en faisant rentrer le pictural par la petite porte de la blague avec les outils les moins appropriés. Et l’artiste d’affirmer en toute simplicité : « C’est un trait qui cherche à entrer en résonance avec la peinture, une supercherie qui cherche à circonvenir la peinture. Et puis, le tableau que tu ne peux pas avoir, tu peux toujours te le dessiner au mur. »
1 Henri Matisse, « Notes d’un peintre », in Écrits et propos sur l’art, Hermann, Paris, 1972.
2 Henri-Georges Clouzot, Le Mystère Picasso, film documentaire, 18 mai 1956.
3 Hans Christian Andersen, Les Habits neufs de l’empereur 1837.
4 Entretien avec Marc Chevalier, Galerie Eva Vautier, Nice, 21 mai 2020.