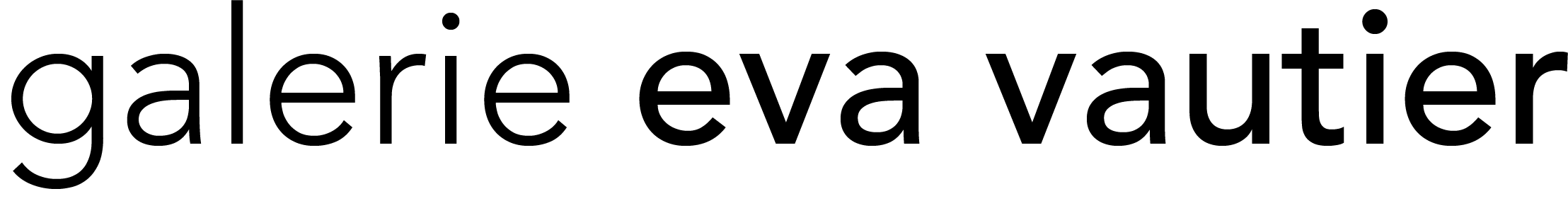[vc_row row_type= »row » use_row_as_full_screen_section= »no » type= »full_width » text_align= »left » background_animation= »none » css_animation= » » css= ».vc_custom_1411208040669{margin: 0px !important;} »][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1586966165400{margin-right: 5% !important;margin-bottom: 200px !important;margin-left: 5% !important;} »]
27 septembre au 6 novembre 2014
AINSI SOIT-IL
Jacqueline Gainon et Frédérique Nalbandian
,
,
Jacqueline Gainon
,
Exposition du 26 septembre au 6 novembre
C’est autour du dilemme entre l’image et la peinture, entre la mémoire et le fantasme, entre les bonnes manières et les jeux interdits que s’articule cette exposition de Jacqueline Gainon dans l’espace de la Galerie Eva Vautier. Placées sous le signe de la couleur, deux séries de grandes peintures bleues et rouges s’affrontent dans des registres diamétralement opposés.
Exécutée dans un style naïf presque léché, la série bleue fait appel aux souvenirs d’enfance de l’artiste : elle repose sur une libre interprétation de photographies d’excursions à la montagne issues d’un album familial. Les images d’origine, prises par le père de l’artiste dans l’arrière-pays niçois, font ici l’objet d’une série d’opérations plastiques. Leur transposition dans un format monumental, le passage du noir et blanc à la couleur et du rendu lisse de la photographie à la matérialité picturale leur confère une indéniable somptuosité. Enfin, tout ce qui relevait du paysage est remplacé par un fond bleu pastel qui rappelle plus le papier peint d’une chambre d’enfant qu’un ciel d’été. Les éléments pittoresques encore présents dans les premières versions de la série — panoramas, sommets rocheux ou calvaires — ont disparu pour laisser place à un espace/temps aussi abstrait qu’intemporel.
Entre image pieuse et mauvais rêve, ces peintures donnent à voir d’étranges portraits incroyablement paisibles dans lesquels l’artiste encore petite fille et les membres de sa famille se tiennent debout les uns contre les autres dans une sorte de demi-sommeil. Leurs yeux sont clos et lorsqu’ils sont ouverts, ils semblent définitivement absents comme si chacun regardait à l’intérieur de lui-même ignorant la présence de l’autre. Parfois leur tête tombe sur le côté ou leur visage s’efface, tandis que leur corps semble flotter dans cette étendue bleue. Leur teint blafard laisse imaginer le pire.
Si l’étrangeté de la scène tient à ce dormir debout collectif, elle est contrebalancée par les gestes de tendresse de ce père et de cette mère à l’égard de leurs quatre enfants. Il y a là quelque chose de touchant, d’encore vibrant qui laisse espérer un dénouement heureux. L’esprit se plaît à imaginer cette famille idéale, bien vivante, les yeux ouverts face à l’objectif photographique car ces images ont quelque chose d’universel, elles pourraient aussi bien être les nôtres. Mais ici l’optique est remplacée par le regard de l’artiste qui traite manifestement ses souvenirs d’enfance de manière psychanalytique au fil des opérations de déplacement qu’elle leur impose. Ainsi, ces bribes du passé ressurgissent à la manière de moments perdus à tout jamais comme si l’artiste ne parvenait pas à restituer la temporalité joyeuse de son enfance mais lui opposait un repos éternel. À l’évidence photographique se substitue l’opacité de la peinture avec sa matérialité grumeleuse et tourmentée.
Avec tendresse et humour, Jacqueline Gainon distord l’idée d’un bonheur familial d’autant plus obsolète qu’il a foutu le camp, affirmant de la sorte quelque chose de l’ordre de l’incroyance en la famille. Derrière la naïveté première de ces grandes icônes qui sont autant de variations sur le thème de la Vierge à l’enfant, mais que l’on pourrait également rapprocher de la pratique populaire des ex-votos par leur côté volontairement maladroit, se profile un inexorable sentiment de perte. Non, la peinture n’est pas chose rassurante, elle est âpre et impure. Et le rôle de l’artiste n’est-il pas celui de brouiller les cartes et de déranger ? Ainsi soit-il.
La série rouge, quant à elle, est infiniment plus gestuelle et expressionniste. Elle obéit à un traitement pictural très fluide qui laisse place à des coulures et des jus colorés. Si la matière est plus transparente que dans la série bleue, cette suite de tableaux est aussi plus plus sombre au sens propre comme au figuré.
Elle met en scène un huis-clos inquiétant dans lequel une petite fille vêtue d’une robe rouge devient la proie d’un groupe de jeunes garçons armés de battes et de pistolets. On y retrouve la fillette qui figurait dans les images de la série bleue avec sa robe année cinquante et dont on suppose qu’il s’agit de la sœur de l’artiste. Mais alors que dans la série précédente l’enfant était sage comme une image, ici elle est représentée en mouvement, dans des postures périlleuses induites par la violence que lui infligent ses tortionnaires. Les yeux bandés, elle est ligotée et frappée. Son petit corps peine à tenir debout tant elle est malmenée. Elle finit par tomber au sol.
Difficile de ne pas être touché par ce qui se donne à voir comme un trauma lointain, d’autant que la fillette semble poussée à l’extérieur du tableau. Si seulement nous était donnée la possibilité de l’aider.
Mais qui sont au juste ses agresseurs qui sortent à peine de l’ombre et dont la silhouette semble appartenir au fond sombre des peintures ? Pour quelle raison s’en prennent-ils à la fillette ? On dirait les membres d’une milice enfantine anonyme. Leurs traits sont effacés comme si la violence n’avait pas de visage. L’œil, il est vrai, est tout entier tourné vers la robe rouge qui virevolte dans l’espace du tableau et qui finit par détourner notre attention. On oublie alors que les garçons sont encore en culottes courtes et que leurs gestes, si on les soumet à un examen attentif, sont un rien maladroits et empruntés. Et s’il ne s’agissait que d’un jeu ? Jacqueline Gainon sème le doute. Alors milice secrète ou bande de scouts ?
On finit par se demander si l’objet de désir de ces jeunes gens n’est pas également le nôtre. Il faut dire que l’artiste a organisé ses compositions en dramatisant à souhait ces saynètes avec leur perspective rabattue et la lumière plongeante qui viennent nous tendre sur un plateau le corps presque érotique de cette enfant à la chair rose toute de rouge vêtue. Nous voici dans la peau du loup. Entre sévices et jeux interdits, ces scènes cauchemardesques et étouffantes viennent contrecarrer l’imagerie d’Épinal de la série bleue et tout ce qu’elle pouvait énoncer de rassurant et d’idéal sur la notion de famille mais aussi et surtout sur l’idée de peinture. Elles nous impliquent dans le jeu érotique de la représentation dont nous devenons les voyeurs.
En regard de cette série picturale très intense figurent d’extraordinaires petits dessins à l’encre de Chine et au feutre gouache où le combat semble se rééquilibrer par endroit. Il arrive alors que la fillette parvienne à tenir en respect ses agresseurs. La victime se fait ainsi bourreau pour le plus grand délice des regardeurs que nous sommes. Pour finir, le petit chaperon rouge dans sa légère robe que l’on voudrait en mousseline se hisse sur un énorme crâne où elle parvient à se tenir en équilibre, faisant ainsi la nique à la mort. Ainsi soit-il.
Catherine Macchi
Sans titre, 2014, Huile sur toile, 146 x 114 cm
Frédérique Nalbandian
,
Frédérique Nalbandian est diplômée de l’École Pilote Internationale d’Arts et de Recherches, Villa Arson, Nice. Depuis ces années passées à expérimenter des formes en devenir, elle raffine sa science des matériaux et son intérêt pour la vaste et troublante question de l’écoulement du temps. Le savon occupe toujours une place prépondérante dans son travail de sculptrice, mais aussi le plâtre et le verre. Au gré des occasions, ces substances se chargent d’eau, d’air, de pigment rouge carmin et de poudre de charbon, s’en laissent imprégner et même meurtrir. Des échanges chimiques s’opèrent donc à l’évidence dans des installations qui épousent les lois de paysages en friche ou dialoguent avec des espaces architecturaux chargés de sens. Dans ces travaux d’où émergent autant de volumes en équilibre que de structures « intranquilles », l’artiste décline des motifs tels que le cercle et la colonne. Dans d’autres réalisations qui disent quelque chose du rapport de l’homme au monde, il s’agit de l’oreille et de l’entente, de mains en prière et de quasi-silence. Ici, des réceptacles avec leurs larges surfaces de vibrations, là, des concrétions faites de plis et de méandres comme ceux du cerveau par exemple. Indéniablement, ces œuvres, de par leur force répétitive et leur pouvoir d’intégration de signes langagiers — il faut écouter les titres que l’artiste attribue à ses oeuvres —, imposent l’idée d’une quête entée sur le poétique et hantée par ce qui en fait le prodige : l’éclosion du sens, sa possible déhiscence, sans le recours à l’argumentation ou au moindre système dialectique. Enfin, il faut dire que Frédérique Nalbandian exécute nombre de dessins où surgit avec plus ou moins de netteté sur le papier, un tissage entre références à l’histoire de l’art et im-précis d’anatomie. Une partition, pourrait-on dire, entre ce qui relèverait du désir de décrire le tournoiement du ciel et celui de remettre l’homme au centre du système …
Texte de Ondine Bréaud-Holland

Périples, Carros 6-01-13, Nice 01-09-14, 2012 2014
savon, marbre, pièce évolutive
200 x 64 x 42 cm
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]